
L'équipe QHSE Lib
06/05/2025Prévenir les risques infectieux en milieu hospitalier : rôle du référent QHSE
Le milieu hospitalier est un lieu de soins, mais également un environnement à haut risque infectieux. Patients fragilisés, actes invasifs, cohabitation de pathogènes, forte densité de passage : les conditions sont réunies pour favoriser la transmission d’agents infectieux, parfois résistants aux traitements. Dans ce contexte, la prévention des infections associées aux soins (IAS) ne relève pas uniquement du personnel médical. Elle implique aussi des fonctions transversales comme le référent QHSE, dont le rôle est souvent sous-estimé mais absolument central.

Garant du respect des normes de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement, ce professionnel agit en coordination avec les équipes soignantes, techniques et administratives pour structurer, contrôler et améliorer les pratiques.
Cet article explore les missions spécifiques du référent QHSE dans la prévention des risques infectieux à l’hôpital, ainsi que les bonnes pratiques à mettre en place pour renforcer la sécurité des patients et du personnel.
I. Comprendre les risques infectieux en établissement de santé
A. Nature des infections associées aux soins
Les IAS regroupent toutes les infections :
- contractées durant un séjour hospitalier,
- liées à des actes de soins (chirurgie, perfusion, pose de cathéter, etc.),
- potentiellement causées par des microorganismes résistants (Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Klebsiella…).
Elles peuvent toucher :
- les patients hospitalisés (infections urinaires, pulmonaires, sites opératoires),
- les soignants (accidents d’exposition au sang),
- l’environnement hospitalier lui-même (surfaces, dispositifs, air, eau).
B. Enjeux humains, économiques et réglementaires
Les IAS représentent :
- une cause majeure de morbidité et de mortalité évitable,
- un coût élevé pour les établissements (prolongation des séjours, traitements, contentieux),
- un risque réputationnel en cas de cluster ou d’épidémie nosocomiale.
Sur le plan légal, les hôpitaux ont une obligation de prévention, de traçabilité et de signalement des infections graves auprès des autorités sanitaires (ARS, Santé Publique France…).
II. Missions du référent QHSE en prévention infectieuse
A. Élaborer et mettre à jour les protocoles d’hygiène
Le référent QHSE, en collaboration avec le service d’hygiène hospitalière :
- participe à la rédaction des procédures de désinfection, nettoyage, stérilisation,
- veille à leur mise à jour en fonction des recommandations nationales (HAUTE Autorité de Santé, SF2H, ECDC),
- coordonne la diffusion des consignes auprès du personnel (y compris non soignant).
Ces documents couvrent aussi bien les soins que :
- l’entretien des locaux,
- la gestion du linge,
- la manipulation des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).
B. Former et sensibiliser les équipes
Le référent QHSE organise ou participe à :
- des sessions de formation continue sur l’hygiène des mains, le port des EPI, la gestion des AES,
- des actions de sensibilisation ciblées : affichages, journées hygiène, quiz sécurité,
- des briefings spécifiques lors de la prise de poste en période épidémique.
Son objectif est de renforcer les bons réflexes et de limiter la variabilité des pratiques.
C. Auditer les pratiques et analyser les écarts
Le référent met en place :
- des visites de terrain régulières (audit hygiène, port des gants, désinfection des dispositifs…),
- des grilles d’observation en collaboration avec les référents médicaux et paramédicaux,
- une analyse des écarts constatés, suivie d’un plan d’action.
Les audits peuvent porter sur les services à risques (réanimation, bloc opératoire, pédiatrie) ou les circuits critiques (stérilisation, restauration…).
III. Renforcer les barrières de prévention grâce au QHSE
A. Sécuriser les flux et circuits hospitaliers
Le référent QHSE cartographie les flux de :
- patients (hospitalisation, consultation, urgence),
- personnel (vestiaires, lieux de repos, circulation interne),
- matériel et déchets.
Il participe à la mise en œuvre de circuits propres/sales et à la séparation des zones pour limiter les contaminations croisées.
Il est également sollicité lors des travaux ou réaménagements, pour garantir la compatibilité des structures avec les exigences d’hygiène.
B. Piloter la gestion des EPI et des consommables
Le QHSE intervient dans :
- la définition des types d’EPI par poste (gants, masques, blouses…),
- le choix des produits de désinfection,
- la traçabilité des consommables critiques.
Il alerte en cas de rupture de stock à risque infectieux ou de défaut qualité d’un fournisseur.
C. Préparer et coordonner la réponse en cas de crise
En cas d’épidémie, de cluster ou d’alerte infectieuse (COVID, Clostridium, SRAS-CoV…), le référent QHSE :
- active un plan de gestion de crise (PCA, plan blanc…),
- coordonne les cellules opérationnelles (communication, isolement, suivi),
- veille au respect des gestes barrières, des circuits COVID/non-COVID,
- documente l’ensemble des actions pour assurer la traçabilité réglementaire.
IV. Mesurer l’efficacité des actions et améliorer en continu
A. Mettre en place des indicateurs de suivi
Le référent QHSE suit des indicateurs spécifiques :
- taux de conformité au lavage des mains,
- taux d’infections nosocomiales par service,
- volume de DASRI collectés,
- résultats d’audits internes.
Il communique ces données aux instances de gouvernance (CME, CLIN, COPIL QHSE).
B. Exploiter les retours d’expérience
Chaque événement (incident infectieux, quasi-accident, plainte…) donne lieu à :
- une analyse de causes (arbre des causes, méthode ALARM…),
- un retour d’expérience (REX),
- des actions correctives formalisées et suivies.
Le référent participe également à la revue de direction QHSE, où il présente les constats et plans d’amélioration.
C. Participer aux démarches qualité et accréditation
En lien avec la démarche HAS/Certification, le référent QHSE contribue à :
- la gestion documentaire (procédures, enregistrements, fiches de poste),
- l’autoévaluation et la préparation des audits externes,
- la culture qualité-sécurité dans l’établissement.
Conclusion
La prévention des risques infectieux ne repose pas uniquement sur les soignants. Le référent QHSE joue un rôle clé de coordination, d’animation, de contrôle et d’alerte, au service de la sécurité des patients et du personnel.
Son action transversale permet de lier les exigences réglementaires aux réalités de terrain, pour bâtir une culture hygiène et sécurité durable.
La vraie question est donc : votre établissement considère-t-il le référent QHSE comme un partenaire stratégique dans la lutte contre les infections nosocomiales… ou comme un acteur secondaire de la prévention ?
#QHSE #HygièneHospitalière #InfectionsNosocomiales #SécuritéDesSoins #SantéSécuritéTravail
Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

Découvrez les distinctions entre QSE, QSSTE, QHSE, HSE et RS, leurs significations, et comment chaqu ... savoir plus

La sécurité au travail est un enjeu majeur pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteur ... savoir plus

Les équipements de protection individuelle (EPI) jouent un rôle crucial dans la prévention des accid ... savoir plus

L’ergonomie en entreprise est un sujet qui prend de plus en plus d’ampleur. Selon l’Assurance Maladi ... savoir plus
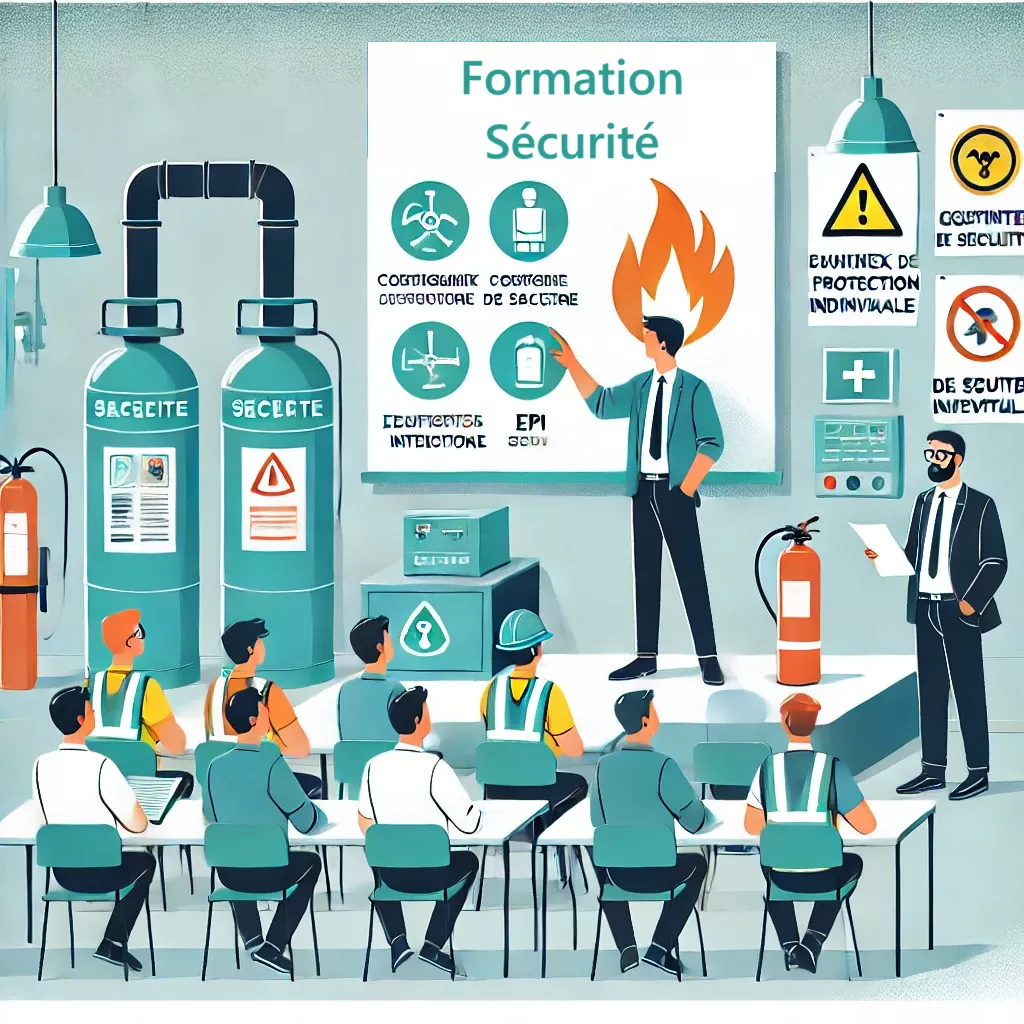
Lorsqu’un nouvel employé rejoint une entreprise, son intégration est une étape clé. Cependant, au-de ... savoir plus

Chaque année, des milliers de travailleurs sont victimes d’accidents sur leur lieu de travail. Si ce ... savoir plus