
L'équipe QHSE Lib
01/09/2025Accidents avec engins de levage : le CACES® suffit-il à prévenir les risques ?
Les accidents liés à l’utilisation d’engins de levage représentent une proportion significative des incidents professionnels dans le secteur de la construction, de la logistique, de la maintenance industrielle et d’autres domaines où la manutention mécanique est courante. Lorsqu’on examine ces situations, il apparaît que ces incidents ont souvent des conséquences graves, voire mortelles, pour les opérateurs, les autres intervenants ou les personnes présentes sur le site de travail.

[Si vous souhaitez vous entraîner à l’un des 8 CACES, vous pouvez vous connecter à votre compte ou en créer un, puis aller dans la rubrique Apprentissage.]
Dans ce contexte, une question centrale se pose rapidement : le Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES®), dispositif instauré pour valider les compétences des opérateurs, est-il réellement suffisant pour assurer une prévention efficace contre ces risques ? Le CACES® garantit-il un niveau de sécurité optimal, ou doit-il être complété par d’autres mesures, méthodes ou formations pour réduire significativement la survenue d’accidents ? Autant de questions que nous allons explorer dans cet article, en apportant une analyse précise, fondée sur les données, la réglementation, ainsi que les bonnes pratiques en matière de prévention.
I. La validité du CACES® : entre reconnaissance de compétences et limitations
A. Qu’est-ce que le CACES® et quel est son cadre réglementaire ?
Créé afin d’harmoniser la formation et l’évaluation des compétences des conducteurs d’engins de levage, le CACES® est une certification officielle mise en place par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) en partenariat avec des organismes de formation certifiées. Il couvre une gamme variée d’engins – chariots élévateurs, nacelles, grues mobiles, engins de chantier, etc. – et comprend une formation préalable alliant théorie (réglementation, sécurité, maintenance de l’engin) et pratique (maniement de l’appareil). L’objectif est d’évaluer la capacité de l’opérateur à utiliser son engin en toute sécurité dans des conditions standardisées. Ce certificat constitue ainsi un référentiel de compétences largement reconnu dans le monde professionnel.
Cependant, contrairement à d’autres dispositifs – tel que l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité de Réseaux), qui impose depuis 2018 une vérification des compétences des personnels intervenant près des réseaux : la détention du CACES® n’est pas explicitement imposée par la réglementation. En effet, le Code du travail prévoit, aux articles R.4323-55 à R.4323-57, que la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’engins de levage ne peut être confiée qu’à des travailleurs formés, et que pour certains engins présentant des risques particuliers, le conducteur doit en outre être titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
Cette obligation réglementaire concerne la responsabilité pénale de l'employeur. Le CACES® s'inscrit dans la responsabilité civil de l'employeur et en particulier l'obligation de résultat. En application L.4121-1, l'employeur peut recourir au dispositif de formation et d'évaluation garantissant la sécurité de ses collaborateurs.
Le CACES® s’est imposé en pratique comme le moyen privilégié pour répondre à cette obligation de formation à la sécurité : il est un référentiel adopté par les partenaires sociaux et piloté par l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) pour mettre à disposition des employeurs un outil d’évaluation normalisé des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique des conducteurs. Autrement dit, sans être nommé dans la loi, le CACES® est recommandé par les institutions de préventions et largement utilisé à l’initiative des employeurs afin d’attester officiellement des compétences des opérateurs et de se conformer à leur obligation de résultat.
B. Les limites intrinsèques du CACES® dans la prévention des accidents
Malgré son rôle central dans la formation des conducteurs, le CACES® ne doit pas être considéré comme une assurance absolue contre les incidents. En effet, plusieurs limites réduisent sa portée dans la prévention des risques :
- Formation standardisée vs. réalité du terrain : la formation CACES® se base sur des scénarios types et des engins standard, mais n’aborde pas toujours la complexité et la diversité de chaque environnement de travail spécifique. Les conditions réelles sur le terrain peuvent réserver des situations imprévues que la formation standard ne couvre pas intégralement. Une formation complémentaire nécessaire, prévue par l'arrêté du 2 décembre 1998, sur l'engin que le conducteur est amené à conduire, et dans le cadre des instructions de sécurité de son site d'emploi.
- Absence d’évaluation continue : le CACES® est une certification ponctuelle, photographiant le niveau de compétence à un instant T. Il ne garantit pas que l’opérateur conserve ses compétences et ses bons réflexes sur le long terme ou qu’il les applique correctement dans des contextes de travail variés. Sans suivi ni entraînement régulier, les acquis peuvent s’estomper. Ainsi, le CACES® doit être renouvelé périodiquement (généralement tous les 5 ans). Un certificat périmé ou non renouvelé à temps peut conduire à une baisse de vigilance ou à un relâchement des pratiques de sécurité.
En conséquence, si le CACES® demeure un outil essentiel pour valider une compétence de base à un instant donné, il ne peut à lui seul prévenir toutes les causes d’accidents liés à l’utilisation d’engins de levage. D’autres facteurs entrent en jeu, que nous examinons ci-dessous.
II. Les causes d’accidents liés aux engins de levage : une problématique multidimensionnelle
A. Facteurs humains et comportementaux
Les erreurs humaines constituent une cause prépondérante dans la genèse des accidents avec engins de levage. Cela inclut une mauvaise évaluation du risque, une surcharge de l’appareil, une mauvaise manipulation ou tout simplement de la négligence. La simple possession du CACES® ne garantit pas qu’un opérateur adopte en permanence un comportement sécuritaire ni qu’il reste vigilant lors de chaque manœuvre. La facteur humain – fatigue, routine, excès de confiance ou stress – peut annuler les bénéfices d’une formation initiale si une culture de sécurité solide n’est pas entretenue au quotidien.
B. Facteurs organisationnels et environnementaux
Les conditions d’organisation du travail et l’environnement jouent également un rôle majeur. Une logistique mal conçue, un chantier mal aménagé, un sol inégal ou encombré, une signalisation insuffisante, ou la présence d’obstacles inattendus peuvent créer des situations à risque élevé. Dans de telles conditions, la vigilance de l’opérateur doit être constamment maintenue, quel que soit son niveau de certification. Un terrain instable ou mal balisé peut multiplier par deux ou trois le risque d’accident, même pour un opérateur certifié et expérimenté. Cela montre qu’au-delà de la compétence individuelle, l’organisation du travail et la gestion de l’espace de travail sont déterminantes pour éviter les accidents.
C. Maintenance insuffisante, équipements défectueux ou mal adaptés
Une proportion importante des incidents est également liée à la défaillance technique ou à la mauvaise utilisation de l’équipement. Si le matériel n’est pas régulièrement contrôlé, entretenu et vérifié, ou si l’opérateur ignore les consignes de sécurité spécifiques à l’engin qu’il utilise, le risque augmente considérablement. Par exemple, une défaillance des freins sur un chariot élévateur ou un capteur de surcharge inopérant sur une grue peuvent conduire à des accidents graves si ces problèmes ne sont pas détectés à temps. Là encore, une formation ne suffit pas : un suivi rigoureux de l’état des machines, une maintenance préventive planifiée et le respect scrupuleux des notices du fabricant sont indispensables pour assurer une utilisation sûre des engins de levage.
III. Comment augmenter l’efficacité de la prévention et réduire la vulnérabilité ?
A. Formation continue et sensibilisation régulière
Formation sur site préalable à l'autorisation de conduite : il s'agit de la formation obligatoire avant de faire conduire l'engin en situation de travail. Comportant une information sur les risques, sur l'environnement et sur les mesures de préventions à mettre en œuvre, c'est le premier levier en matière de prévention des accidents avec des appareils de manutention et de levage. Pour en savoir plus lire l'article suivant.
Des sessions de formation pratique sur le terrain – par exemple lors d’exercices encadrés de conduite d’engins de manutention – permettent de renforcer les acquis du CACES® et d’entretenir les bons réflexes de sécurité. Au-delà de l’obtention initiale du certificat, il est primordial d’organiser régulièrement des formations continues, des ateliers de sensibilisation et des exercices de simulation. Ces actions complètent la formation de base en consolidant la culture de sécurité de l’entreprise. La formation doit rester dynamique et évolutive, en s’adaptant aux nouvelles réglementations, aux innovations technologiques, et surtout en tirant parti des retours d’expérience du terrain. Cette amélioration continue des compétences assure que les opérateurs restent à jour et conscients des risques, même longtemps après leur formation CACES® initiale.
B. Procédures rigoureuses et gestion proactive des risques
Les entreprises doivent établir des protocoles de sécurité précis, spécifiques à leur activité et à leur environnement de travail. Cela inclut des procédures claires pour le contrôle systématique de l’état des machines (vérifications quotidiennes, hebdomadaires, etc.), la planification sécurisée des tâches (pour éviter précipitation et improvisation), ainsi que la gestion de la circulation dans les zones à risques (plan de circulation, zones d’exclusion autour des engins en fonctionnement, balisage temporaire des chantiers, etc.). En formalisant de telles règles et en veillant à leur application rigoureuse, on réduit la dépendance envers la seule compétence de l’opérateur au moment T. Une procédure bien pensée anticipe les dangers et encadre le travail de chacun, de sorte que même en cas d’inattention humaine, les dispositifs de sécurité en place viennent réduire la probabilité d’un accident.
C. Suivi, audit et contrôle permanents
La prévention ne s’arrête pas à la formation initiale ni à la mise en place de procédures – elle doit s’inscrire dans la durée par un contrôle permanent. Des audits réguliers des pratiques sur le terrain, combinés à un système de retour d’expérience (signalement des presque-accidents, remontée des infractions aux règles, etc.), permettent d’ajuster en continu les dispositifs de sécurité. Mettre en place des inspections inopinées, des évaluations périodiques des opérateurs en situation de travail, ou encore des échanges formels lors de réunions sécurité contribue à maintenir un haut niveau d’exigence. De plus, une supervision active – par exemple via un manager ou un coordinateur QHSE présent sur le terrain – renforce la vigilance collective et permet une intervention rapide en cas de dérive ou de danger imminent. Ce suivi dans la durée est le complément indispensable de la formation : il ferme la boucle de la prévention en s’assurant que les bonnes pratiques sont effectivement appliquées au quotidien.
D. Culture de sécurité et implication de tous les acteurs
Enfin, aucune mesure de prévention ne sera pleinement efficace sans une véritable culture de sécurité partagée par tous les acteurs de l’entreprise. Cela implique la participation active de la direction, de l’encadrement intermédiaire et de chaque employé ou intervenant externe. La sécurité doit devenir une valeur collective : encourager la communication ouverte sur les sujets de sécurité, reconnaître et récompenser les bonnes pratiques, responsabiliser chacun quant à son comportement, sont autant de leviers pour ancrer la prévention dans les habitudes. Une culture de sécurité forte se traduit par une vigilance collective accrue – les collègues se surveillent mutuellement et n’hésitent pas à signaler un danger ou un écart de conduite – et par un engagement visible de la hiérarchie. Lorsque la sécurité est perçue non comme une contrainte administrative, mais comme une priorité partagée et un facteur de fierté professionnelle, les comportements à risque diminuent nettement. C’est cet état d’esprit collectif qui, au final, réduit significativement la probabilité d’accidents, bien plus sûrement que n’importe quel certificat.
Conclusion
La possession d’un CACES® par un opérateur demeure une étape essentielle de la prévention des accidents impliquant des engins de levage – elle assure que l’opérateur a acquis au minimum les compétences techniques de base pour manœuvrer l’engin en sécurité. Cependant, il apparaît clairement que cette certification à elle seule ne suffit pas à éliminer tous les risques liés à la conduite d’engins, surtout dans des environnements de travail complexes et changeants. Un conducteur titulaire d'un CACES® peut encore être victime d’un accident si le contexte de travail est mal maîtrisé, ou s’il ne met pas en pratique les bons comportements.
Il est donc impératif pour les entreprises de déployer un dispositif global de prévention qui associe : une formation et un entraînement continus des conducteurs, une organisation du travail rigoureuse (procédures, règles claires, supervision), un entretien régulier des machines et des équipements de sécurité, et le développement d’une culture de sécurité partagée à tous les niveaux. Ce n’est qu’au prix de cet effort global, au-delà de la simple obtention du CACES®, que les accidents liés aux engins de levage pourront être durablement réduits.
En d’autres termes, le CACES® est un bon départ, mais la vigilance de tous les instants et l’engagement collectif pour la sécurité font toute la différence sur le terrain. La prévention efficace des risques exige d’aller bien au-delà du certificat, afin de protéger véritablement les opérateurs et l’ensemble des travailleurs exposés.
[Si vous souhaitez vous entraîner à l’un des 8 CACES, vous pouvez vous connecter à votre compte ou en créer un, puis aller dans la rubrique Apprentissage.]
Cet article a été rédigé en collaboration avec l'organisme de formation suivant : VERIFRANCE
#QHSE #SécuritéTravail #EnginsDeLevage #PréventionDesRisques #Formation #CACES® #SantéSûreté #ManagementDeSécurité #CultureSécurité #RespectDesRéglementations
Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

Découvrez les distinctions entre QSE, QSSTE, QHSE, HSE et RS, leurs significations, et comment chaqu ... savoir plus

La sécurité au travail est un enjeu majeur pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteur ... savoir plus

Les équipements de protection individuelle (EPI) jouent un rôle crucial dans la prévention des accid ... savoir plus

L’ergonomie en entreprise est un sujet qui prend de plus en plus d’ampleur. Selon l’Assurance Maladi ... savoir plus
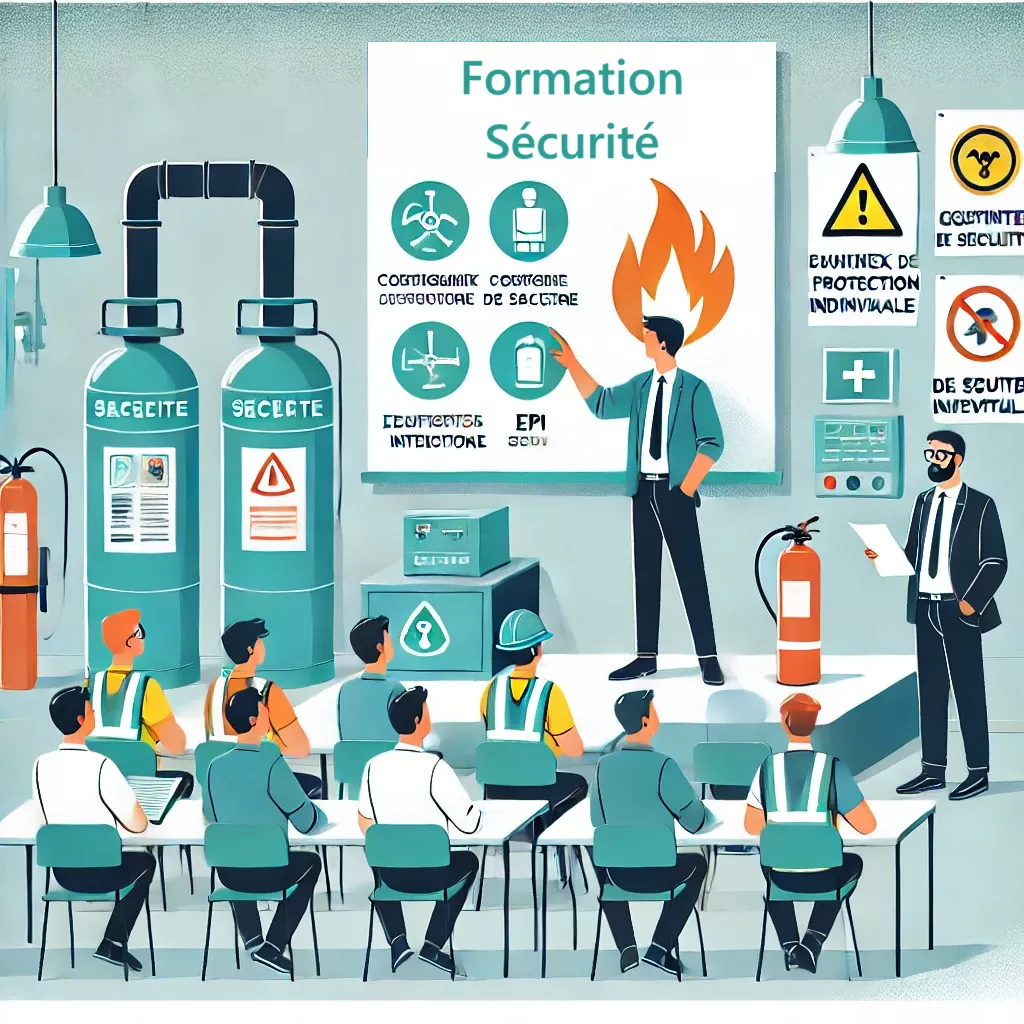
Lorsqu’un nouvel employé rejoint une entreprise, son intégration est une étape clé. Cependant, au-de ... savoir plus

Chaque année, des milliers de travailleurs sont victimes d’accidents sur leur lieu de travail. Si ce ... savoir plus